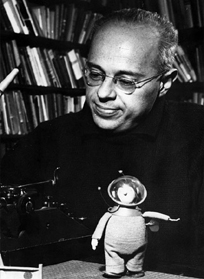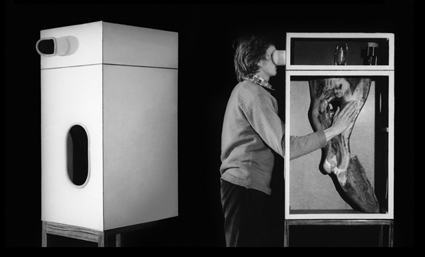Æsthetica-Nova
Æsthetica-Nova
|
>
|
Józef Bury, La culture cybernétique et
les démarches expérimentales dans l'art des pays de l'Est — L'exemple de la
Pologne Transcription revue et corrigée de la conférence
prononcée par Józef Bury dans le cadre d'" Extra-muros " —
Rencontres de l’université au musée. Art, cultures et technologies. Cycle de
conférences et de présentations 2007/2008 : " Le vivant et
l’artificiel ", Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain MAMAC -
Université de Nice Sophia-antipolis : http://xavierromain.free.fr/maquette/mamac/jozef_bury.html Résumé Le développement de la cybernétique
coïncide avec la scission de la civilisation occidentale en deux blocs
concurrentiels, opposés du fait de la Guerre froide. Adoptée avec
enthousiasme aux États-Unis dans les années 40, la culture cybernétique
exerce une influence ambiguë dans les pays de l'Est. Durant les années 40,
elle se trouve condamnée par l'idéologie communiste en tant que perversion de
l'impérialisme et démarche anti-humaniste. À la fin des années 50, elle
s'érige en science autonome et participe au programme de recherche qui
aboutit en 1961 à la conquête soviétique de l'espace grâce à un vol habité.
L'exposé présentera quelques exemples historiques de l'art polonais inscrits
dans ce contexte. Contexte historique
général Lorsque l'on souhaite s'intéresser à
l'histoire de la science dans les pays de l'Est, et donc en particulier à
l'histoire de la cybernétique, on est très vite confronté à une difficulté
dans l'accès à l'information. Tout d'abord, le secret défense couvrait — et
couvre encore — tout ce qui relevait des technologies nouvelles, et surtout
celles qui étaient liées à la conquête de l'espace et à l'industrie militaire
: c’était le cas de la cybernétique. Deuxièmement, on ne saura peut-être
jamais quel était le décalage réel entre le discours officiel et la
pratique : comment savoir sur quoi travaillaient les services de
renseignement, les services d'espionnage industriel et les laboratoires de
recherche perdus dans l'immense étendue de l'Union soviétique ?
Troisièmement, la recherche scientifique menée à l'époque en URSS et dans la
majorité des pays de l'Est était en quelque sorte
" anonyme " et " collective ". Il est
très difficile d'en tirer une histoire au sens occidental, structurée par les
noms de chercheurs et les " individus ", alors que
ceux-ci pouvaient se trouver, pour des raisons politiques, dépossédés d'un
jour à l'autre de leurs recherches et finir leurs jours au goulag. Bien évidemment, même dans cette
histoire collective, il y a des faits indéniables. Les Soviétiques inventent
très tôt, dès 1950, les premiers ordinateurs, le M1 en 1950 et le BESM en
1953, et réalisent plusieurs étapes dans la conquête de l'espace, ce qui
aboutira en 1961 au premier vol habité. Ces faits, bien établis, laissent
deviner que les avancées de la recherche soviétique ont été réellement
considérables. La société civile apprenait ces
découvertes dans la presse et à la télévision et ceci, la plupart du temps, à
l'occasion des grandes manifestations du 1er mai ou lors de
la date d'anniversaire de la Révolution. Lors de ces événements, les noms des
scientifiques héroïques étaient mis en avant au même titre que ceux des
ouvriers modèles, et toujours pour des raisons politiques, de propagande.
Autrement dit, le scientifique n'était considéré individuellement qu'à titre
emblématique, en tant qu'avant-garde d'un nouveau modèle de société. Fig. 1. Ordinateur "M1", URSS 1950 En ce qui concerne la cybernétique
proprement dite, la séparation de la civilisation occidentale en deux blocs
concurrentiels opposés du fait de la Guerre froide se traduisait dans les
pays de l'Est par une critique systématique de toute idéologie venant de
l'Occident. Et la cybernétique n'échappait pas à cette règle. Ainsi, dans le discours officiel des
années 40, la cybernétique se trouve condamnée par l'idéologie communiste en
tant que perversion de l'impérialisme et démarche anti-humaniste. Les
discours officiels dénoncent la volonté de " contrôle "
de la personne humaine et le projet d'utilisation de la cybernétique par
l'État pour manipuler les masses. La cybernétique est dénoncée comme
" pseudoscience ", " science
des obscurantistes ", " science
bourgeoise " ou " épidémie ". En 1947 encore,
le père de la cybernétique américaine, Norbert Wiener lui-même, est qualifié
de " matérialiste mécaniste ". Cela ne va changer qu'après
ses publications ultérieures qui critiquent la société américaine.1 De manière générale, donc, dans l'URSS
d'après-guerre, la cybernétique est considérée comme contraire à l'idéologie
marxiste. Or, soudainement, lors du discours de Khrouchtchev au Congrès du
Parti, en 1961, la cybernétique apparaît comme une théorie à promouvoir.2 De plus, malgré les critiques officielles
précédentes, il est évident que dès la fin des années 50, la cybernétique est
érigée en science autonome, partie prenante des programmes de recherche
militaire et spatiale. La situation pourrait donc être résumée
de la manière suivante. Différents programmes de recherche scientifique,
parfois très avancés, étaient en réalité menés en URSS et dans la plupart des
pays du Pacte de Varsovie, cela sans que le mot
" cybernétique " soit d'usage. C'est l'appellation même
qui posait un problème, pour des raisons politiques et culturelles. Jusqu'à
la fin des années 50, la culture cybernétique, c'est-à-dire, tout ce qui
était véhiculé par cette " idéologie " (car c'est ainsi
qu'elle était désignée), faisait l'objet, quant à elle, de critiques
violentes de la part des sciences humaines, surtout en URSS. Le monde
communiste usait donc de toute sa puissance de propagande pour dénigrer cette
nouvelle science émergente. En quelque sorte, le tout-puissant Parti
communiste encourageait à la fois la recherche scientifique et la critique
humaniste, exploitant les deux versants. La
critique alimentait la propagande contre Occident et la recherche servait les
programmes militaires et spatiaux. Il est également certain qu'en dépit
des déclarations officielles, l'idée de contrôle de la société, de maîtrise
scientifique de la communication, et même une certaine idée de robotisation
de la société n'étaient pas étrangères aux dirigeants communistes, comme le
montre le rapport Kovalenkow, rédigé au début de l’année 1946. " Il
s’agit d’une prise de position en faveur de l’automatisation de l’industrie,
telle qu’elle est prévue dans le plan quinquennal 1946-1950 "3. Jérôme Segal cite à ce propos Jacques Bergier qui
rend compte de ce rapport en 1948, dans la revue marxiste Les Lettres
françaises : " L’automatisation des industries d’un grand
pays suivant un plan ordonné, préconçu, rationnel et dans le cadre d’un
programme général de reconstruction exige donc une liaison entre la science
pure et les techniques, comme on n’en avait encore jamais fait "4. Notons
au passage que si l'Occident apprenait ce qui se passait en URSS par les
articles qui paraissaient dans les revues communistes, la fiabilité de ces
sources reste encore à démontrer : la propagande soviétique était
redoutable et se servait très bien de ces canaux pour faire passer aux
Occidentaux tous les messages qu'elle avait besoin de faire passer. Enfin, aux yeux des Soviétiques, la
cybernétique est officiellement réhabilitée " après 1954-55,
lorsque le célèbre mathématicien A. Kolmogorow ainsi qu'A. Khintchin
concentrent leurs activités sur la théorie de l'information, vue comme une
partie du calcul des probabilités, avec une approche exclusivement
scientifique et loin de toutes applications en dehors des sciences dites
exactes. Ainsi Kolmogorov peut venir en 1956 au MIT, et les deux articles de
Khintchin de 1953 et 1956 sont édités en même temps aux Etats-Unis et en RDA
en 1957. "5 En
d'autres termes, c'est à partir du moment où les Soviétiques disposent de
leur propre cybernétique — dont l'efficacité est démontrée par des programmes
spatiaux et dont la valeur est reconnue aux États-Unis à travers des
publications scientifiques — que Khrouchtchev peut, lors du congrès du Parti
en 1961, souligner l'intérêt de cette science. La culture cybernétique Le sujet de la science cybernétique en
URSS demande à être étudié avec beaucoup de patience et de précaution à la
fois sur le plan politique et scientifique. Ce dont on peut parler avec
davantage de certitude, c'est l'état de la conscience collective à ce
sujet : c'est-à-dire, justement, de la " culture
cybernétique ". Dans les premières années
d'après-guerre, le courant cybernétique exerce une influence ambiguë dans les
pays de l'Est. Les intellectuels de l'Est examinent cette nouvelle culture, certes
avec fascination, mais aussi avec beaucoup de méfiance. De plus, de ce point
de vue, les pays de l'Est présentent des différences considérables. Dans
l'Union soviétique, la culture cybernétique a été considérablement
discréditée par de longues années de critique, parfois très violentes. Ainsi,
même après la déclaration favorable de Khrouchtchev au congrès du Parti, en
1961, il a fallu attendre plusieurs années pour que les sciences humaines se
rangent du côté de la position alors adoptée. En RDA, la recherche était
considérablement affaiblie par la déportation des scientifiques allemands
dans les camps de recherche en URSS. Cela a évidemment affaibli toute la
recherche en sciences humaines à ce sujet. Par contre, en peut affirmer sans
trop de risque qu'en Pologne, la culture cybernétique a joué un rôle
important et a participé réellement à l'émergence de quelques faits
artistiques. Dans l’après-guerre, en Pologne et dans
les pays de l'Est en général, on savait qu'aux États-Unis dans les années 40,
la cybernétique avait été adoptée et développée avec enthousiasme. On savait
également qu'elle était critiquée en URSS par les sciences humaines. Et
c'étaient déjà, en quelque sorte, deux raisons en soi pour que le milieu des
sciences humaines en Pologne lui soit beaucoup plus ouvert et réceptif. Il faut dire également que le mot
" cybernétique " même avait été inventé en Pologne en
1834 par un philosophe polonais, Bronislaw Ferdynand Trentowski, en même
temps que par André-Marie Ampère en France.6 Rappelons à ce titre les premières publications
concernées : André-Marie Ampère (1775 - 1836), 1834
: Essai sur la philosophie des sciences ou Exposition analytique d'une
classification naturelle de toutes les connaissances humaines. Bronislaw Ferdynand Trentowski (1808-1869),
1834 : Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rzadzenia narodem
(Cybernétique. Les liens de la philosophie avec la cybernétique, ou art de
gouverner une nation). Norbert Wiener (1894-1964), 1948 :
Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine. Il paraît donc évident que la
cybernétique américaine, définie en 1947 par Norbert Wiener —
" lui-même d’origine polono-russe par son père "7 — a trouvé en Pologne un terrain beaucoup plus
fertile et a considérablement fécondé l'imagination collective. Stanislaw Lem (1921
-2006) Le premier domaine
" contaminé " a sans doute été la littérature, avec la
figure de Stanislaw Lem. Lem a été non seulement un représentant majeur de
cette culture, mais il l’a encore influencée dès la fin de la seconde guerre
mondiale.
Fig. 2. Stanislaw Lem, en 1966. Lem est bien entendu l'auteur de
plusieurs romans qualifiés à l'époque de romans de
" science-fiction " mais il est également perçu très tôt
comme un véritable philosophe des " sciences du futur ".
Lem parle dans ses romans de la cybernétique, de la manipulation cérébrale,
de la robotique, du clonage humain, de la communication avec les
extra-terrestres, etc. Il influence la culture polonaise de la fin des année
40 par ses nombreuses publications : en 1951, Astronauci (écrit en 1946) ; en
1961, Solaris (porté à l'écran par Andreï Tarkovski en 1971) ; en 1961,
Ksiega robotów ; en 1965, Cyberiada, et une trentaine d'autres livres
écrits jusqu'à sa mort en 2006. Dans son autobiographie8 Lem affirme qu'après son déménagement de Lvov à
Cracovie, en 1946, il a repris ses études de médecine mais, surtout, qu’il a
été (1948-1950) l'assistant du docteur Mieczyslaw Choynowski (1909 - 2001) au
Conservatoire scientifique à Cracovie. Choynowski — et c'est là que l'on
touche les vraies origines de l'intérêt pour cette nouvelle culture en
Pologne — était un médecin psychiatre et un scientifique reconnu, considéré
aujourd'hui comme le pionnier de la psychologie en Pologne et le père de la
psychométrie polonaise. À l'époque, Dr Choynowski était un initiateur de
Konserwatorium Naukoznawcze (Conservatoire scientifique) à Cracovie et
l'éditeur du mensuel Zycie Nauki (La Vie de la science) ; plus tard, il
a été membre de l'Association internationale de cybernétique. Le Conservatoire scientifique, pensé par
Choynowski comme un laboratoire de recherche, était un centre d'échange
d'idées nouvelles, parfaitement inscrit dans le paysage intellectuel de
Cracovie. Or, Choynowski était parfaitement initié à la recherche des
avant-gardes artistiques, par le biais de son ami proche Witkacy (Stanislaw
Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy, 1885-1939), un des artistes les plus
influents et le plus significatifs en Pologne, jusqu’à sa mort en 1939. C'est donc tout naturellement que
Stanislaw Lem, se repérant à partir de ce qu’il connaissait des milieux de la
science et de la culture, est allé voir Choynowski pour lui montrer ses
premiers écrits. Choynowski l’a pris immédiatement sous
sa protection et l’a recruté comme son assistant. Ce qui allait d'ailleurs
lui causer bientôt quelques ennuis, avec la fermeture de son laboratoire, en
1950, en partie à cause de Lem (j'y reviendrai tout à l'heure). C'est Choynovski qui a incité Lem à
lire les ouvrages étrangers relevant des domaines de la logique, de la
psychotechnique et de la génétique. De nombreux ouvrages étrangers étaient
alors disponibles via l'université, et c'est de cette manière que Lem a lu
les livres de Wiener comme The Human Use of Human Beings. Mais ces éléments
ne sont pas suffisants pour expliquer l’existence d’un phénomène aussi
extraordinaire que la littérature de Stanislaw Lem dans un pays du bloc
communiste. Lem parlait russe, français, allemand
et latin et il travaillait pour le mensuel scientifique La Vie de la science
dirigé par Choynowski, faisant les comptes rendus de périodiques
scientifiques étrangers. C'est à ce titre qu’il a eu l’indélicatesse de
produire un compte rendu trop " personnel " d'un débat
qui se déroulait en URSS et auquel étaient mêlées les figures majeures de la
science soviétique. Il s'agissait en occurrence d'une polémique entre les
généticiens russes et un certain Lysenko (Trofim Denisovich Lysenko, 1898 —
1976), qui défendait la thèse de la possibilité illimitée de transformation
des organismes sous l'influence de l'environnement, ainsi que la thèse de la
transmission héréditaire des caractéristiques apprises ou assimilées durant
la vie. Lysenko travaillait sur le germe de blé, mais du point de vue
idéologique, ses conceptions trouvaient une écoute attentive auprès de
Staline, qui rêvait d'une société nouvelle, modelable à volonté et pouvant
transmettre ses enseignements d'une génération à l'autre. Lysenko est donc
devenu un protégé de Staline, qui l’a promu à la tête de l'Institut des
Études génétiques au sein de l'Académie des Sciences agronomiques de l'URSS
(limogeant au passage l'ancien directeur et l’envoyant en Sibérie). Voici donc qu’un jeune écrivain de
science-fiction de Cracovie se confronte à Lysenko, un protégé de Staline,
s’aventurant ainsi sur le terrain des sciences génétiques et soulevant ainsi
un débat important. C'est cet événement qui a contribué à la fermeture du
laboratoire de recherche de Choynowski et qui a donné une certaine
" visibilité " à Lem, au risque de lui coûter sa liberté. Il a
surtout été obligé de chercher immédiatement des arguments solides. Lem a
donc passé en revue toutes les publications de la science occidentale pour se
forger des références irréfutables et pour parer d’éventuelles attaques
politiques. Voici donc comment Lem s’est trouvé condamné à devenir un
spécialiste des sciences génétiques, de la biologie, de la robotique, de la
cybernétique et des tests d’intelligence. C'est donc dans cette perspective qu'on
devrait regarder les conditions d'émergence de la culture cybernétique en
Pologne. Lem en était un acteur majeur, mais lui-même avait été en quelque
sorte initié à la culture de l’art expérimental par Choynowski. Choynowski
fusionnait en effet, en sa personne-même, les différents rôles de chercheur
en psychométrie, de membre de l'Association internationale de cybernétique,
ce qui lui procurait un certain contact avec les sociétés savantes à
l’étranger, et d’initié de l’avant-garde par le biais de l’amitié avec
Witkacy. Lem lui-même a affirmé sa dette à
l'égard de Witkacy. Ses nombreux articles et nouvelles sont écrits dans un
style qu'on pourrait rapprocher du " style polémique " de
Witkacy. Witkacy était un artiste expérimental dans tous les sens du terme,
qui travaillait souvent en lien étroit avec des médecins et des psychiatres.
C'était encore le premier artiste polonais qui s’était fait psychanalyser (en
1912, par Dr de Beaurain, disciple de Freud). Enfin, en tant qu'ami
proche de l'anthropologue Bronislaw Malinowski, il connaissait parfaitement
les grands courants de pensée de son époque. Les origines de cette culture
cybernétique se situent donc dans un contexte d’échanges et de contacts
étroits entre les scientifiques et les artistes avertis. On peut même dire
que cette culture trouve ses origines dans un milieu de scientifiques,
d’anthropologues, de médecins et de psychiatres, qui fréquentaient les
milieux artistiques d'avant-garde, sans oublier évidemment l'apport théorique
venu des États-Unis. Les arts plastiques L'exemple de Lem témoigne d'un
questionnement présent largement dans toute la culture littéraire de
l'époque. Dans le domaine des arts plastiques — ce qui nous intéresse plus
particulièrement dans le cadre de cet exposé — deux exemples, parmi d'autres,
retiendront toute notre attention : deux artistes majeurs qui ont compris très
tôt les enjeux de cette nouvelle pensée. Wlodzimierz Borowski
(né en 1930) Borowski étudie l'histoire de l’art
(1952-55) à l’Université catholique de Lublin et commence son activité
artistique par une pratique de différents styles de peinture (abstraction,
surréalisme, dadaïsme...). Il développe ensuite, sans aucune filiation
directe, les préoccupations les plus osées de l’art mondial, aujourd’hui
largement discutées et diffusées. Ce sont, pour ne citer que les plus
tangibles : l’interactivité technologique, sensorielle, la vie
artificielle, l’exhaustivité (syncrétisme) des thématisations d’une situation
réelle donnée, l’investigation des déformations de l’espace, les problèmes du
rendement des événements artistiques dans les " partitions "
composées de descriptions langagières et formelles. Cette œuvre, chargée
émotionnellement et symboliquement, a souvent des connotations écologiques
prononcées. En 1958, il construit ses premiers Artons, formes
organiques vouées à une vie autonome, et conçoit des organismes capables de
réagir à la présence humaine, grâce au mouvement de l’air et température9.
Fig. 3. Wlodzimierz Borowski, Arton B, 1958. Muzeum
Sztuki w Lodzi
Fig. 4. Wlodzimierz Borowski, Arton 1, 1961. Muzeum
Sztuki w Lodzi
Fig. 5. Wlodzimierz Borowski, Arton XI, 1962.
Muzeum Sztuki w Lodzi Borowski affirme qu'il envisageait de
faire des études scientifiques et qu'il était particulièrement intéressé par la
possibilité de créer une vie artificielle. Il choisit cependant les études
d'histoire de l'art et plus tard, à partir de 1958, il réalise ses idées sous
forme de propositions artistiques. " J’étais attiré par les
sciences de la vie, par toutes les tentatives et expérimentations en vie
artificielle, la robotique et le début de l’ordinateur. J’essayais moi-même
de faire, réalisant ainsi mon rêve démiurgique, des formes-créatures vouées à
une vie autonome. Dotées de systèmes électromagnétiques complexes, mes
créatures avaient une capacité de réaction aux mouvements de l’air, par
changement de formes et émission de lumière. Je les nommais
"Artony". J’ai suivi tous les progrès de la science, mais
l’envisager comme étude sérieuse me paraissait trop difficile. J’ai donc
choisi les sciences humaines10. " Or, Borowski manifeste également le
plus grand intérêt à l'égard de Witkacy, ami de Choynowski :
" Witkacy, avec son ironie et sa distance vis-à-vis de son travail,
dépassait déjà les frontières et les conventions. Son expérience était
dirigée vers les limites du supportable, tout en restant drôle. J’ai connu
Witkacy à travers ses écrits littéraires et ses travaux théoriques sur le
théâtre, plus qu’à travers son travail plastique. C’est le Witkacy dans son
ensemble que je trouve extrêmement intéressant, dans ses excès, dans son
éclatement des frontières et son "inassouvissement"11. " Il avoue aussi ses fascinations pour
Joyce, Malevitch et Kandinsky. Mais il cite surtout, comme source
d'inspiration, l'œuvre de Karol Hiller (1891 - 1939) artiste peintre,
d'orientation constructiviste et abstraite.
Fig. 6. Karol Hiller, Kompozycja heliograficzna XIV
(Composition héliographique), 1935-37. Muzeum Sztuki w Lodzi
Fig. 8. Karol Hiller, Embrion, 1933. Muzeum Sztuki
w Lodzi " Je me souviens d’une visite
au Musée de Lodz où j’ai découvert la peinture et le graphisme de Karol Hiller,
ce fut pour moi un moment intense. J’éprouvais devant ses œuvres une
expérience d’ouverture de l’espace, le tableau devenait une brèche vers un
autre monde. Depuis, cette sensation révèle pour moi la qualité de l’œuvre12. " L'œuvre de Karol Hiller constitue un
univers onirique et psychotechnique, composé de formes mutantes. Borowski
affirme que c'est à partir du moment où il a vu le travail de Karol Hiller
qu'il a pris conscience d'une certaine possibilité de réaliser une vie
artificielle sous forme d’œuvre d'art. Andrzej Pawlowski
(1925 — 1986) Artiste, théoricien de l’art (peinture,
sculpture, architecture, photographie, films, design). Après des études dans
le département des Eaux et Forêts à l’Université Jagiellonski de Cracovie et
des études en architecture intérieure à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie
(1944-50), il devient enseignant aux Beaux-Arts en 1963 et crée le premier
département de Formes industrielles — Design — en Pologne. Il reste directeur
de ce département jusqu’en 1970, et de 1981 jusqu’à sa mort en 1986. Il
formule une théorie des " formes constituées
naturellement " (où l’action de différentes forces sur les
matériaux les conduisent à prendre une forme résultant de leur structure
interne — moulages de sacs, écrasement de matériaux...), qu'il applique, à la
fois dans son art et dans l'enseignement du design. En 1963-64, il crée les
" Stymulatory wrazen nieadekwatnych " (stimulateurs de
sensations inadéquates), sculptures-matériaux parfois mobiles, cachées dans
des boîtes en carton et exploitables tactilement à travers des trous-manches.
Ces objets sont accompagnés de différentes images-situations, par exemple une
bougie allumée, des éléments tranchants-piquants, des morceaux de verre...
inadéquatement associés aux éléments contenus dans les cartons. En 1966, il
énonce sa " Conception des pôles énergétiques ", comme
alternative au concept d’expérience esthétique. Selon cette conception,
l’artiste génère, crée et porte un pôle énergétique spécifique, résultat d’un
processus de création, qui n’est pas matérialisable sous forme de tableaux,
sculptures, partitions13. Pawlowski définit ce pôle énergétique
comme énergie qui se propage par seuils, donc non-continuellement et
non-ondulatoirement ; qui obéit à la loi de diffraction et de réflexion ;
qui a besoin, pour se propager ainsi d'un certain milieu spécifique.
L'artiste et le spectateur sont définis comme des émetteurs et des
récepteurs. Un récepteur peut modifier cette énergie et devenir un émetteur à
son tour. La matérialisation, ou plutôt l'inscription, de l'œuvre-énergie
peut générer son propre pôle énergétique, qui en est également le stimulateur
et le catalyseur. Pawlowski parle ensuite du rôle des
" archives ", précisant que les archives de l'inscription
de ces énergies peuvent être particulièrement bénéfiques pour l'amplification
des pôles énergétiques. Il qualifie l'art et la théorie de l'art comme
sciences qui demandent à être considérés avec des critères d'objectivation.
Et il termine en prédisant une possibilité future de maîtrise et de mesure
des flux d'énergie aussi bien des points de vue qualitatif que quantitatif.
Il précise également que cela permettra le stockage et l’accumulation de ces
énergies, ainsi que la mesure " à la source " et non
seulement au moment de la réception14. On est frappé par ces conceptions qui
s'appliqueraient aujourd'hui à l'art numérique et aux œuvres-stimulis
polysensoriels, ainsi qu'à la circulation, au stockage et à la gestion des
œuvres en réseau. Les propositions d'Andrzej Pawlowski
des années 1963-1966, et en particulier sa Conception de champ énergique, les
Stimulateurs des impressions inadéquates et les Modèles stéréognosiques se
sont inscrits dans le processus de préparation de la situation actuelle de
l'art " transdisciplinaire " et " interactif ",
qui se basent sur l'interaction sensorielle et sur la transmission
télématique du " champ énergique immatériel " spécifique,
qui caractérisent l’expérience esthétique à l'époque d'Internet.
Fig. 10. Andrzej Pawlowski, cycle Formy naturalnie
uksztaltowane (formes constituées naturellement), 1963
Fig. 11. Andrzej Pawlowski, Stimulateurs des
impressions inadéquates, 1963 - 1964 L'hypothèse du
" clonage photographique " Pour terminer, je voudrais présenter —
à titre d'hypothèse, et essentiellement sous forme des associations
iconographiques — une certaine vision du clonage sous forme photographique
apparue dans l'art polonais au début du XXe siècle. Fig. 12. Witkacy, Autoportrait multiple, 1914-1917 Il nous faut, tout d'abord, revenir à
Witkacy, l'artiste expérimental à la réputation sulfureuse, l’ami de
Choynowski et le proche collaborateur de Malinowski. Dès le début de ses
expérimentations photographiques, Witkacy ne cesse de mettre en scène de
manière obsessionnelle sa propre personne, sous forme de multiples séries
d'autoportraits. L'une des premières expériences de ce type, réalisée en
1914-1917, est un portrait multiple à l'aide d'un dispositif photo-optique
qui démultiplie le modèle, en le déclinant par des vues de faces, de dos et
de profil. Le cas de Witkacy n'est pas un cas
isolé. Il semblerait qu'un dialogue formel soit à l'œuvre entre les artistes
des différentes générations. Quelques années plus tôt, en 1912, le même
portrait est réalisé par un autre artiste savant : Waclaw Szpakowski.
Fig. 13. Waclaw Szpakowski, Autoportrait multiple,
1912. Plus tard, c'est le même dispositif
optique de mise en multiple, qui serait revendiqué formellement par Borowski
en 1966. De plus, dès les années 80 un autre artiste contemporain de domaine
multimédia et vidéo expérimentale, Józef Robakowski décline la figure du
style, réalisant plusieurs autoportraits ou portraits multiples de ses amis.
Enfin, Barbara Konopka, " multipliée " déjà par
Robakowski, réalise son propre autoportrait multiple en 1998-2000, pour ne
citer qu'un exemple parmi d'autres artistes appartenant à la génération
contemporaine15.
Fig. 14. Wlodzimierz Borowski, 1ère démonstration syncrétique,
Galerie BWA, Lublin 1966
Fig. 15. Józef Robakowski, Autoportrait multiple, à
suivre..., installation vidéo, 1998 Fig. 16. Barbara Konopka, Autoportrait multiple,
1998 - 2000 Ce " dialogue des
formes " dépasse d'ailleurs largement les frontières polonaises.
Par exemple, mentionnons qu'Umberto Boccioni a réalisé son portrait multiple
en 1907 et que Duchamp et Henri-Pierre Roche ont fait de même en 1917. Fig. 17. Umberto Boccioni : Io Noi Boccioni,
photomontage, 1907-1910 Fig. 18. Marcel Duchamp, Autoportrait multiple,
1917 Fig. 19. Henri-Pierre Roche, Autoportrait multiple,
1917. Références sur Internet : Wlodzimierz Borowski Karol Hiller Barbara Konopka Stanislaw Lem Andrzej Pawlowski Józef Robakowski Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy Notes : 1 D'après Jérôme Segal, « L’introduction de la cybernétique
en R.D.A. Rencontres avec l’idéologie marxiste. », texte publié dans Science, Technology and Political Change.
Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège,
20-26 July 1997), volume I, sous la direction de D. Hoffmann, B.
Severyns et R.G. Stokes, Brepols, Turnhout, 1999, pp. 67-80, rééd. http://jerome-segal.de/Publis/Cyb-DDR.htm 2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 D'après Robert Vallée, « Précurseurs et premières figures
de la cybernétique et de la systémique en Europe », in Res-Systemica, revue
européenne de systémique, vol. 5, Actes
du VIe Congrès européen de systémique, Paris, septembre 2005,
2005. 7 Ibid. 8 Pour la biographie de Stanislaw Lem (1921 -2006), voir notamment
le site officiel de l'écrivain : http://www.lem.pl/ 9 Józef Bury, « Contexte d’apparition des pratiques
artistiques de type performance en Pologne - Entretiens avec Zbigniew Dlubak,
Wlodzimierz Borowski, Jerzy Beres et Józef Robakowski", Æsthetica-Nova (Paris), n°6, 1996, pp.
40-70, rééd. : http://art.action.anamnese.free.fr/conclusion.html 10 Ibid., rééd. http://art.action.anamnese.free.fr/borowski.html 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid., rééd. http://art.action.anamnese.free.fr/conclusion.html 14 Voir notamment Andrzej
Pawlowski – Inicjacje, Wydzial Form Przemyslowych ASP Krakow, 2001. pp.
49-52. 15 Voir également la présentation des portraits multiples par Józef
Robakowski in : Józef Robakowski, Magia zwierciadla – Portrety wielokrotne,
Galeria Labirynt - BWA Lublin, 1991. |
|
|
|